Avenue Hoche, le silence a remplacé le tumulte. Mais un parfum d’encens et de rose flotte encore, comme si l’âme d’Anna de Noailles hantait toujours ces lieux où elle régna sur le Tout-Paris intellectuel durant près de trois décennies. Poétesse d’origine roumaine et grecque, première femme commandeur de la Légion d’honneur, muse de Proust et amie de Cocteau, elle incarna cette Belle Époque où la poésie avait encore le pouvoir d’enflammer les cœurs et de faire tourner les têtes.
Une princesse entre deux mondes
Le 15 novembre 1876, Anna-Elisabeth Bibescu Bassaraba de Brancovan naît dans le luxe feutré d’un hôtel particulier parisien. Son père, le prince Grégoire de Brancovan, descend d’une lignée d’hospodars roumains. Sa mère, Rachel Musurus, est la fille d’un pacha turc, née à Constantinople, mais élevée à Londres. Cette double ascendance orientale marquera profondément l’imaginaire de la future poétesse.
L’enfance d’Anna se partage entre Paris et la villa Bassaraba à Amphion, sur les rives du lac Léman. La mort de son père en octobre 1886 constitue le premier grand traumatisme. Anna n’a que dix ans. C’est dans les Contemplations de Victor Hugo qu’elle trouve les mots pour exprimer sa douleur. L’année suivante, sa mère l’emmène dans un voyage initiatique en Orient-Express jusqu’à Constantinople. À onze ans, Anna découvre émerveillée le Bosphore et le palais Musurus. Cette traversée jusqu’aux portes de l’Orient nourrira à jamais sa poésie.
Dix ans plus tard, en 1897, Anna épouse le comte Mathieu de Noailles et entre dans la vieille aristocratie française. Elle lui donnera un fils unique, Anne-Jules, en 1900. Dans Le Côté de Guermantes, Proust immortalisera cette union : « Un cousin de Saint-Loup avait épousé une jeune princesse d’Orient qui, disait-on, faisait des vers aussi beaux que ceux de Victor Hugo et d’Alfred de Vigny… »
Le salon de tous les possibles
Avenue Hoche, entre l’Étoile et le parc Monceau, le salon d’Anna devient rapidement l’épicentre de la vie littéraire parisienne. André Gide, Paul Valéry, Edmond Rostand, François Mauriac, Colette, Cocteau… tous viennent écouter – ou subir – l’éloquence intarissable de la maîtresse de maison. Mauriac notera avec agacement : « Le vacarme de son monologue qui tue autour d’elle toute conversation. Elle porte son feu d’artifice à domicile. »
Anna de Noailles incarne une liberté rare pour une femme de son milieu : elle fume, conduit, voyage seule, reçoit qui elle veut. Sans jamais se revendiquer féministe, elle ouvre des portes, force des barrières, impose sa voix dans un monde d’hommes. Paradoxe fascinant d’une aristocrate qui brise les conventions tout en les incarnant.
C’est de ce salon que jaillira, en 1901, Le Cœur innombrable. Le recueil fait l’effet d’un coup de tonnerre. Anna a vingt-cinq ans et devient la coqueluche du Paris littéraire. Sa poésie renoue avec le lyrisme romantique tout en y insufflant une sensualité inédite. Dans Les Éblouissements (1907), son recueil le plus accompli, elle déploie tout son art : exaltation panthéiste de la nature, obsession de la mort, désir charnel à peine voilé. Cette « chaude Arabe aux yeux de loup », comme elle se décrit, apporte à la poésie française des parfums d’ailleurs. Ses vers bruissent de « sureaux aux parfums framboisés », résonnent du chant des cigales « cymbalines », s’enivrent de « l’odeur de sucre, de poivre, de rose, de pampre, de lin, de gruau ».
Les tourments du cœur
Mais derrière cette façade mondaine et ce succès littéraire se cache une femme déchirée par des amours impossibles. À partir de 1903, elle entame avec Maurice Barrès une liaison ardente, mais platonique qui durera vingt ans. Lui, marié, chantre du nationalisme ; elle, dreyfusarde, socialiste proclamée. Tout les oppose, hormis cette fascination mutuelle qui les consume. D’autres attachements la traversent : le jeune philosophe Henri Franck, mort de tuberculose en 1912, la plonge dans le désespoir. Dans Les Vivants et les Morts (1913), elle écrit avec une lucidité déchirante : « J’ai vécu pour cela, qui est déjà fini ! » L’amour, chez elle, est toujours vécu sur le mode de la perte. Elle est « celle que l’on quitte ».
La Grande Guerre bouleverse tout et précipite les deuils. Mathieu part au front, Anna se réfugie chez Edmond Rostand dans sa villa Arnaga au Pays basque. Les années qui suivent voient s’accumuler les disparitions : la grippe espagnole emporte Rostand en 1918, puis sa mère et Barrès meurent tous deux en 1923. Anna de Noailles bascule définitivement du côté de l’ombre.
Les honneurs et les ombres
Les reconnaissances officielles pleuvent pourtant sur elle : Grand Prix de l’Académie française en 1921, première femme à l’Académie royale de Belgique en 1922, première femme commandeur de la Légion d’honneur en 1931. Mais ces honneurs ne parviennent pas à combler le vide laissé par tant de deuils. Son fils unique, Anne-Jules, mène sa propre vie. Anna se retire progressivement du monde.
Une tumeur au cerveau la fait souffrir. La femme qui électrisait les salons reçoit désormais allongée dans sa chambre transformée en alcôve orientale, aujourd’hui reconstituée au Musée Carnavalet, face à celle de Proust – deux écrivains qui transformèrent leur réclusion en œuvre d’art.
L’Honneur de souffrir (1927) témoigne de cette obsession grandissante de la mort. En 1930, elle publie Le Livre de ma vie, autobiographie inachevée. Ses derniers vers sont sans appel : « Je refuse l’espoir, l’altitude, les ailes/Il n’est rien qui survive à la chaleur des veines. »
Anna de Noailles s’éteint le 30 avril 1933. Son corps est inhumé au Père-Lachaise, mais son cœur repose dans une urne au temple de la villa Bassaraba, face au lac de son enfance.
L’éternelle exilée
Après sa mort, Anna de Noailles sombre dans l’oubli. Trop mondaine, trop lyrique pour les avant-gardes. Pourtant, à la relire aujourd’hui, on découvre une modernité insoupçonnée : liberté de ton sur la sexualité féminine, panthéisme écologique, athéisme revendiqué. « Il n’est plus de cieux ni de dieux », écrivait-elle dans Les Éblouissements. Elle fut aussi une femme d’influence, cofondatrice en 1904 du prix Vie Heureuse, futur prix Femina. Rodin sculpta son buste, les peintres se disputaient son portrait.
Dans l’un de ses derniers poèmes, elle exprimait une angoisse qui résonne étrangement aujourd’hui : « Que je meure n’est rien, mais faut-il qu’elle meure/Elle, la Terre heureuse et grave, la demeure/Des humaines ardeurs, des travaux et des jeux ! … » Cette inquiétude écologique avant l’heure révèle la profondeur de sa vision. Anna de Noailles reste l’éternelle exilée, ni tout à fait française ni vraiment étrangère, ayant ciselé ses vers entre l’ombre et la lumière, entre le désir et son impossible accomplissement. Dans le panthéon des Grandes Dames, elle occupe cette place unique : celle qui transforma son déracinement en poésie universelle.
© OLIVIER AUBRIET
Préfacier de la réédition du livre Edmond Rostand de Rosemonde Gérard aux éditions Kilika, 2024. Passionné par Edmond Rostand et collectionneur, membre du conseil d’administration des Amis d’Arnaga et d’Edmond Rostand.
Sources consultées :
- François Broche, Anna de Noailles, un mystère en pleine lumière, Robert Laffont, 1989
- Site de l’Association Anna de Noailles (annadenoailles.org)
- Louis Perche, Anna de Noailles, Seghers, 1964
- Archives du Musée Carnavalet, Paris
Correctrice : Isabelle Benard

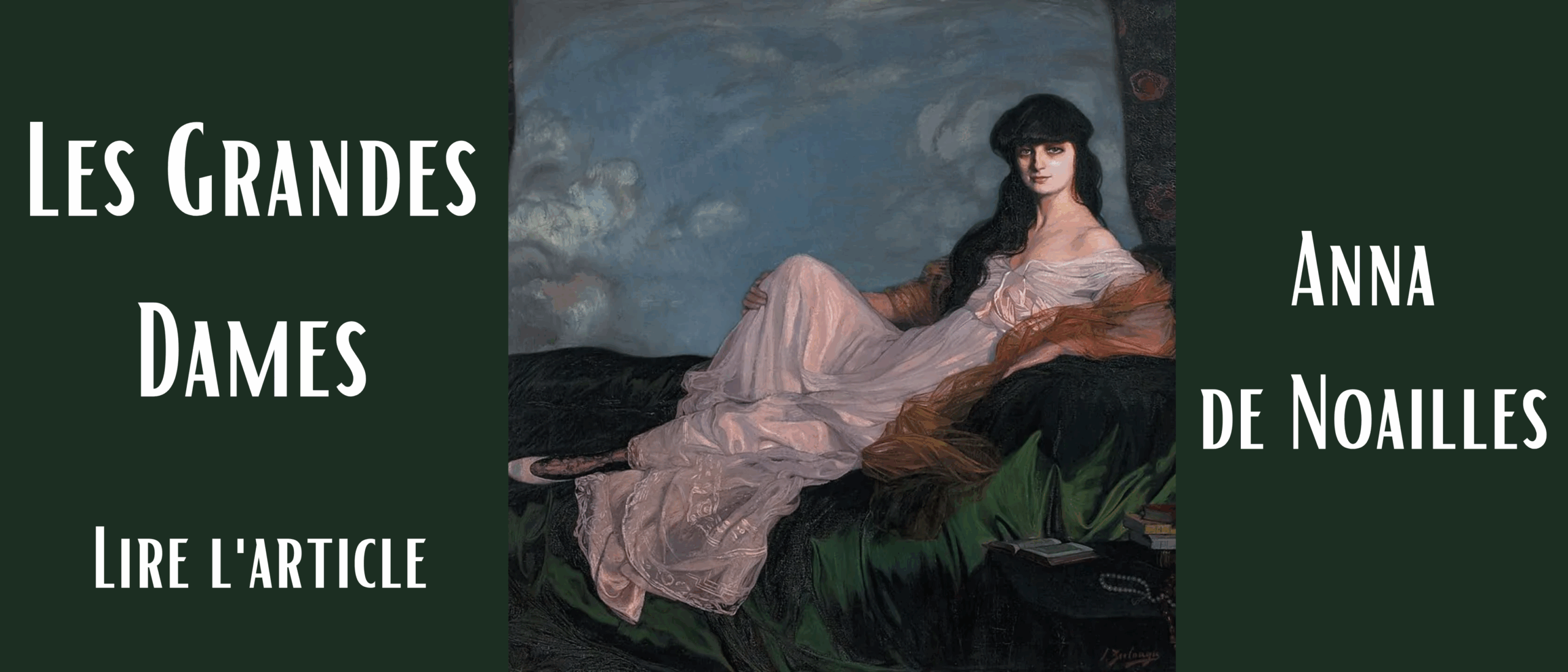
Laisser un commentaire